 J’ai eu du mal à entrer dans le monde de Juan Rulfo. Peut-être parce que ces dix-huit nouvelles ont les défauts de leur format: très courtes, elles ne racontent pas des histoires, à peine des moments dans la vie des hommes, et peignent les tableaux de la misère qui condamne au malheur, à la violence, à la tristesse.
J’ai eu du mal à entrer dans le monde de Juan Rulfo. Peut-être parce que ces dix-huit nouvelles ont les défauts de leur format: très courtes, elles ne racontent pas des histoires, à peine des moments dans la vie des hommes, et peignent les tableaux de la misère qui condamne au malheur, à la violence, à la tristesse.
L’écriture elle aussi, très belle, maîtrisée, procède par images frappantes. Dans un Mexique essentiellement rural, sur une terre ingrate, des paysans prennent les armes et mettent le Llano, leur propre terre, à feu et à sang; une vache emportée par la crue condamne une jaune fille pauvre à la prostitution; des hommes essaient de passer des frontières, de survivre en territoire hostile, d’échapper à la misère, de ne pas mourir. Mais ils en sont incapables: on n’échappe pas à son destin.
Juan Rulfo voit-il tout en noir? Peut-être. Il s’attache en tous cas à décrire un monde incroyablement noir, loin des images (sont-ce des clichés?) que l’on peut avoir d’une Amérique latine pauvre et généreuse, fêtarde et passionnée. La misère n’appelle rien d’autre que la misère. L’amour, rare, est un piège qui n’offre qu’un répit illusoire, quand il ne mène pas à la folie et à la trahison. L’ivresse, y compris celle des jours de fête, dégénère en mélancolie ou en pugilat. La famille est un nœud de serpents, dont l’héritage pèse lourd. Le gouvernement, lointain, invisible, est une sangsue dépourvue de sens politique. Et la révolution, inévitable, dévaste la terre de ceux qui se battent sous leurs propres pieds.
Ce sont des nouvelles qui se méritent. Avec lesquelles il te faudra prendre ton temps. Elles ne sont ni drôles, ni tendres, ni légères. Il te faudra bien affronter le désespoir en face. Mais parfois, c’est tout simplement nécessaire.


 Dans un joli conte émouvant, Ketty Steward remonte aux origines et nous rappelle, à nous humains cruellement égoïstes, pourquoi les oignons nous font pleurer (Légende aux petits oignons). Matthieu Grossi réserve d’horrifiques et peut-être métaphysiques surpises à Totor, son héros à la coule et à tête de concombre (L’oisiveté). Mélanie Kalamarius massacre les tomates mais résoud les problèmes de couple (Si même les tomates meurent). Dans son potager, l’oncle Charles génial et farfelu fabrique des graines avec la même fantaisie et les mêmes effets imprévisibles qu’E-Traym met à écrire des histoires (Le potager de l’oncle Charles). Les frères Cuisson, bien sûr, mettent leur grain de sel dans le civet de connil et dans la littérature – celle qu’ils aiment, qu’ils l’aient lue ou pas. Et c’est Le Nootilus qui se colle cette fois à l’illustration du numéro.
Dans un joli conte émouvant, Ketty Steward remonte aux origines et nous rappelle, à nous humains cruellement égoïstes, pourquoi les oignons nous font pleurer (Légende aux petits oignons). Matthieu Grossi réserve d’horrifiques et peut-être métaphysiques surpises à Totor, son héros à la coule et à tête de concombre (L’oisiveté). Mélanie Kalamarius massacre les tomates mais résoud les problèmes de couple (Si même les tomates meurent). Dans son potager, l’oncle Charles génial et farfelu fabrique des graines avec la même fantaisie et les mêmes effets imprévisibles qu’E-Traym met à écrire des histoires (Le potager de l’oncle Charles). Les frères Cuisson, bien sûr, mettent leur grain de sel dans le civet de connil et dans la littérature – celle qu’ils aiment, qu’ils l’aient lue ou pas. Et c’est Le Nootilus qui se colle cette fois à l’illustration du numéro.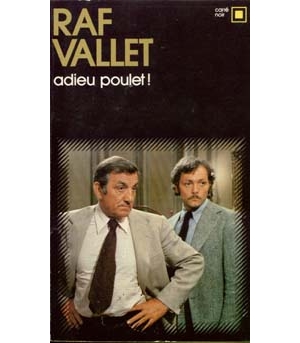 De temps en temps, j’aime m’offrir la lecture d’un bon vieux carré noir, tout plein de flingues, de coups qui tombent dur, et d’hommes à la virilité stéréotypée. Souvent des flics, même. Et assez incompréhensiblement* avec des famapoiles sur l’illustration de couverture. Mais j’assume.
De temps en temps, j’aime m’offrir la lecture d’un bon vieux carré noir, tout plein de flingues, de coups qui tombent dur, et d’hommes à la virilité stéréotypée. Souvent des flics, même. Et assez incompréhensiblement* avec des famapoiles sur l’illustration de couverture. Mais j’assume.
 La tétralogie du Yorkshire, tome deux
La tétralogie du Yorkshire, tome deux Harding a perdu sa licence de détective privé, il y a quelques années. Pour meurtre. Il a fait de la prison. Maintenant, il bosse pour Donnie Wilson, fait de petits boulots un peu en marge, un peu délicats. En ce moment, il espionne les mercredis soirs du docteur Rosenberg, dont la femme veut divorcer. Le problème n’est pas tant que le monsieur a une idée très hard core de l’infidélité conjugale (encore qu’on espère que tout le monde, lors de ces petites soirées, est effectivement consentant) – au contraire, ce sera très pratique pour le divorce. Non, le souci, c’est qu’il est trop perfectionniste. Il faut dire que le docteur est chirurgien esthétique. Alors s’il décèle le moindre défaut chez sa sublime femme (une trace de cellulite, des pattes d’oie), il la frappe, la brûle. Et Harding est un homme trop juste, trop intègre, pour ne pas se laisser entraîner, en prenant la défense d’Elenya Rosenberg, jusqu’au point limite: celui où tout peut basculer, et le ramener à ses vieux démons.
Harding a perdu sa licence de détective privé, il y a quelques années. Pour meurtre. Il a fait de la prison. Maintenant, il bosse pour Donnie Wilson, fait de petits boulots un peu en marge, un peu délicats. En ce moment, il espionne les mercredis soirs du docteur Rosenberg, dont la femme veut divorcer. Le problème n’est pas tant que le monsieur a une idée très hard core de l’infidélité conjugale (encore qu’on espère que tout le monde, lors de ces petites soirées, est effectivement consentant) – au contraire, ce sera très pratique pour le divorce. Non, le souci, c’est qu’il est trop perfectionniste. Il faut dire que le docteur est chirurgien esthétique. Alors s’il décèle le moindre défaut chez sa sublime femme (une trace de cellulite, des pattes d’oie), il la frappe, la brûle. Et Harding est un homme trop juste, trop intègre, pour ne pas se laisser entraîner, en prenant la défense d’Elenya Rosenberg, jusqu’au point limite: celui où tout peut basculer, et le ramener à ses vieux démons.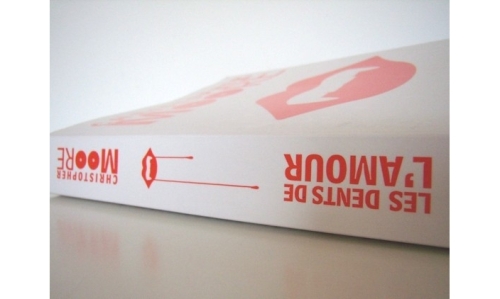 Dans la liste des bons côtés: tu as une chevelure de rêve (finies les fourches), tu fais de très grosses économies sur la facture d’électricité (car tu vois dans le noir) et sur les courses (car tu n’as plus besoin de manger).
Dans la liste des bons côtés: tu as une chevelure de rêve (finies les fourches), tu fais de très grosses économies sur la facture d’électricité (car tu vois dans le noir) et sur les courses (car tu n’as plus besoin de manger). Alice, dite Aliki, dite Kiki. Une petite campagnarde à moitié orpheline, une adolescente au tempérament explosif, un modèle pour les peintres de la Butte, l’égérie et amoureuse de Man Ray (et de quelques autres). Elle a froid, faim, et fait la fête dès qu’elle a un peu d’argent. Elle aime l’excès, n’a peur que de l’ennui. Elle est la reine de Montparnasse, un temps, avant la déchéance. Mais quoiqu’il lui arrive, Kiki garde sa liberté, et ne suit que ses envies.
Alice, dite Aliki, dite Kiki. Une petite campagnarde à moitié orpheline, une adolescente au tempérament explosif, un modèle pour les peintres de la Butte, l’égérie et amoureuse de Man Ray (et de quelques autres). Elle a froid, faim, et fait la fête dès qu’elle a un peu d’argent. Elle aime l’excès, n’a peur que de l’ennui. Elle est la reine de Montparnasse, un temps, avant la déchéance. Mais quoiqu’il lui arrive, Kiki garde sa liberté, et ne suit que ses envies.
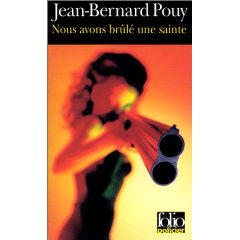 Une fille et trois garçons. Jeanne et trois de ses lieutenants. Engagés dans une guerre loufoque et sanglante contre les Anglais, les Bourguignons, la société. Quatre mômes pas encore adultes qui veulent de l’air et marchent sur les traces de la Pucelle d’Orléans, pour venger l’Histoire et un genou foutu, et par amour aussi.
Une fille et trois garçons. Jeanne et trois de ses lieutenants. Engagés dans une guerre loufoque et sanglante contre les Anglais, les Bourguignons, la société. Quatre mômes pas encore adultes qui veulent de l’air et marchent sur les traces de la Pucelle d’Orléans, pour venger l’Histoire et un genou foutu, et par amour aussi.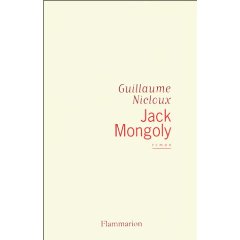 À une époque de ma vie où j’allais beaucoup au cinéma, j’avais vu, bien par hasard d’ailleurs, Une affaire privée de Guillaume Nicloux. C’était merveilleusement glauque et retors. J’avais adoré. J’avais appris ensuite qu’il était écrivain. Enfin, qu’il était aussi écrivain. Certaines personnes sont douées. Mais comme le hasard guide mes lectures, il m’a fallu attendre toutes ces années avant de poursuivre l’expérience.
À une époque de ma vie où j’allais beaucoup au cinéma, j’avais vu, bien par hasard d’ailleurs, Une affaire privée de Guillaume Nicloux. C’était merveilleusement glauque et retors. J’avais adoré. J’avais appris ensuite qu’il était écrivain. Enfin, qu’il était aussi écrivain. Certaines personnes sont douées. Mais comme le hasard guide mes lectures, il m’a fallu attendre toutes ces années avant de poursuivre l’expérience.


